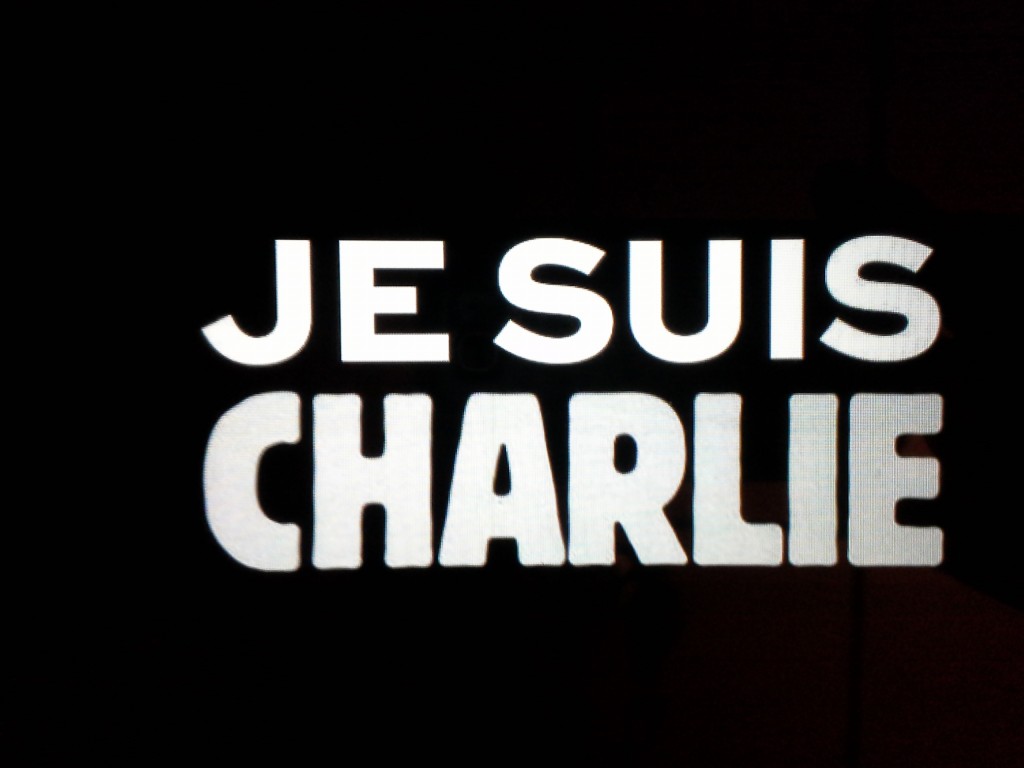Nouvel échec pour une demande de marque tridimensionnelle devant l’OHMI.
L’arrêt du 24 février 2016 du Tribunal est là.
29 décembre 2011 : dépôt de la demande de marque :

Pour :
– classe 6 : « Métaux communs et leurs alliages ; matériaux de construction métalliques ; serrurerie et quincaillerie métalliques ; produits métalliques non compris dans d’autres classes ; bouteilles métalliques » ;
– classe 21 : « Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine ; verre brut ou mi-ouvré (à l’exception du verre de construction) ; verrerie, porcelaine et faïence non comprises dans d’autres classes ; bouteilles en verre et en plastique » ;
– classe 32 : « Bières ; eaux minérales et gazeuses et autres boissons sans alcool ; boissons à base de fruits et jus de fruits ; sirops et autres préparations pour faire des boissons ».
23 janvier 2013 : rejet par l’examinateur.
27 mars 2014 : la Chambre de recours rejette le recours.
Le 24 février 2016, le Tribunal rejette le recours du déposant, la société Coca-Cola Cie.
42 À cet égard, selon la description fournie par la requérante, la marque demandée est composée d’une base plate qui présente une courbe vers l’extérieur pour donner une apparence bombée, d’une section conique qui s’effile vers l’intérieur et s’étend vers l’extérieur jusqu’à la première ligne horizontale pour dessiner une forme trapézoïdale, d’une partie centrale saillante légèrement encastrée et ayant une apparence plate, bien que les côtés marquent une légère courbe, pour dessiner un profil lisse, et d’une partie supérieure qui s’effile vers le haut comme un entonnoir et qui est légèrement bombée au niveau du goulot.
43 Il s’ensuit que la marque demandée est un signe complexe composé de plusieurs caractéristiques.
44 Partant, il convient, aux fins de l’appréciation du caractère distinctif de la marque demandée, de la considérer dans son ensemble. Toutefois, cela n’est pas incompatible avec l’examen successif des différents éléments qui la composent….
45 Tout d’abord, en ce qui concerne la partie basse de la marque demandée, il y a lieu de considérer que cette partie de la bouteille ne présente pas de caractéristiques permettant de la distinguer d’autres bouteilles disponibles sur le marché. Il est notoire que des bouteilles peuvent présenter des parties basses de formes très variées. Cependant, de telles variations ne permettent pas, en général, au consommateur moyen de déduire l’origine commerciale des produits concernés.
46 Ensuite, s’agissant de la partie centrale de la marque demandée, il convient de relever que celle-ci ne présente pas non plus de particularités par rapport à ce qui est disponible sur le marché. Comme l’a relevé à juste titre la chambre de recours, cette partie de la marque demandée sert, dans des conditions commerciales normales, à accueillir une étiquette sur laquelle figureraient le nom de la marque, des informations sur les ingrédients à l’attention des consommateurs, la capacité de la bouteille et les noms du producteur et du distributeur. Le fait que cette partie soit légèrement courbée n’implique pas qu’elle confère à la marque demandée un caractère distinctif permettant aux consommateurs de déduire son origine commerciale.
47 Enfin, pour ce qui concerne la partie supérieure de la marque demandée, qui est composée d’un entonnoir légèrement bombé au niveau du goulot, il convient d’observer qu’il est notoire que les bouteilles disponibles sur le marché présentent des caractéristiques plus ou moins semblables à celles de la marque demandée. En effet, la partie supérieure d’une bouteille est généralement en forme d’entonnoir et comporte un goulot. Il s’ensuit que, même en admettant que cet élément présente une certaine originalité, il ne saurait être considéré comme divergeant significativement des normes ou des habitudes du secteur.
48 Ainsi, la marque demandée est constituée par une combinaison d’éléments dont chacun, étant susceptible d’être communément utilisé dans le commerce des produits visés dans la demande d’enregistrement, est dépourvu de caractère distinctif par rapport à ces produits (voir, en ce sens et par analogie, arrêt Forme d’une bouteille de bière, point 38 supra, EU:T:2004:120, point 30).
49 Il ressort de la jurisprudence que le fait qu’une marque complexe n’est composée que d’éléments dépourvus de caractère distinctif par rapport aux produits concernés permet, en règle générale, de conclure que cette marque, considérée dans son ensemble, est dépourvue de caractère distinctif……
51 La marque demandée ne constitue ainsi qu’une variante de la forme et du conditionnement des produits concernés qui ne permettra pas au consommateur moyen de distinguer les produits en cause de ceux d’autres entreprises [voir, en ce sens, arrêts du 17 décembre 2008, …..
52 Dès lors, la chambre de recours n’a pas commis d’erreur en estimant que le consommateur moyen de l’Union percevrait la marque demandée, dans son ensemble, uniquement comme une variante de la forme et du conditionnement des produits pour lesquels l’enregistrement de ladite marque est demandé.